

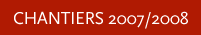


Ecosse : Le petit frère veut s’émanciper
in New Statesman [1], Courrier International, n°860, 26 avril - 2 mai 2007
Un jour, à Jérusalem, j’ai assisté à un office à la St Andrew Scots Memorial Church, une église écossaise construite à proximité de la vieille ville. Le sermon, prononcé par un prêtre palestinien issu de la tradition chrétienne presbytérienne, était consacré à saint André et aux raisons pour lesquelles les Ecossais et les Palestiniens ont tant d’affinités avec lui. Pour le prêtre, il n’y avait aucun doute sur ceci : des deux apôtres André et Pierre, qui étaient frères, comme il nous l’a rappelé, Pierre était le plus valeureux. Pierre, en effet, qui pêchait au filet, gagnait des foules entières à la cause de la toute jeune Eglise, tandis qu’André était un pêcheur à la ligne se contentant de sauver les âmes une à une. Et le prêtre conclut que, comme les Ecossais, André, saint patron des seconds rôles, se satisfaisait de vivre dans l’ombre d’un partenaire plus important – je n’invente pas. Jérusalem est un bien long voyage pour assister à un sermon sur les faiblesses de votre pays.
« L’écosse n’est pas aujourd’hui plus nationaliste que dans les années 1970 »
Mais le prêcheur a marqué un point. Les Ecossais de ma génération se souviennent de l’échec du référendum de 1979 sur la dévolution : à 19 ans, c’était la première fois que je votais. Le lendemain, The Herald publiait un dessin du lion d’Ecosse, non plus fièrement cabré mais servilement blotti dans un coin, accompagné de cette légende : “J’ai peur.” L’Ecosse a-t-elle toujours peur ? Je ne pense pas qu’elle soit aujourd’hui plus nationaliste que dans les années 1970, et elle est certainement nettement moins repliée sur elle-même qu’elle ne l’était. Ce n’est pas l’affirmation d’une nouvelle identité écossaise qui représente une menace pour l’Union [de l’Angleterre, du pays de Galles et de l’Ecosse]. C’est le déclin continu, en Ecosse, du sentiment d’identité britannique, la lente déliquescence du consensus établi sur ce que signifie réellement être britannique. J’ai grandi dans le Galloway, l’extrémité sud-ouest du pays qui s’avance dans la mer d’Irlande, entourée d’eau et séparée du reste de l’Ecosse par une bande de terres rocheuses incultivables : je vivais quasiment sur une île. Enfants, on nous emmenait sur les tombes de Margaret McLachlan et de Margaret Wilson, martyres du XVIIe siècle condamnées à mort par noyade pour avoir refusé de renoncer à leur foi presbytérienne à une époque où le roi tentait d’imposer depuis Londres l’Eglise épiscopale tant exécrée. On nous a enseigné que ces deux martyres étaient mortes pour avoir refusé de se soumettre à la morale d’étrangers venus du Sud. En 1974 – je me souviens du choc –, le Galloway a envoyé un député nationaliste à Westminster. Dans tous les lieux publics était placardé ce slogan : “Ce pétrole est celui de l’Ecosse”. Mes parents, qui avaient apprécié de vivre en Angleterre, abhorraient ce ton xénophobe. Dans les années 1970, le Scottish National Party (SNP, Parti national écossais) me semblait aveuglé par un délire romantique : tourné vers le passé, centré sur la notion d’héritage, obsédé par une déplaisante conception ethnique de ce qu’était l’Ecosse. Hostile à l’Union européenne autant qu’au Royaume-Uni, c’était un parti séparatiste au sens fort du terme. Quelques années plus tard, Alex Salmond et les autres “modernisateurs” ont fini par prendre le contrôle du SNP. Ils en ont fait un parti social-démocrate européen, purgé du sentiment antianglais que tant d’Ecossais détestaient et redoutaient.
« Dans les années 1980, les Ecossais déploraient le “déficit démocratique" »
La Grande-Bretagne a changé, elle aussi. Dans les années 1980, en discutant de l’Ecosse avec des amis anglais, j’ai souvent remarqué la même réaction typique, désagréable, s’articulant en deux temps. D’abord une incrédulité blessée : comment pouvez-vous nous traiter ainsi, après tout ce que nous avons fait pour vous ? Suivie d’un air de défi irrité : partez donc – on s’en fiche (signifiant : vous reviendrez bientôt en pleurant). Maintenant, mes amis anglais ne semblent plus blessés. Ils sont plutôt las, voire agacés, de cette indécision sans fin. Dans les années 1980, les Ecossais déploraient le “déficit démocratique”. Les sondages montraient que les Anglais éprouvaient de la sympathie pour les Ecossais, et leur soutien à la dévolution était parfois plus élevé que parmi les Ecossais. Mais, aujourd’hui, ils ne sont plus d’accord. Il ne s’agit pas uniquement de la “West Lothian question”. [Pourquoi les députés écossais à Westminster ont-ils le droit d’intervenir dans les dossiers anglais, alors que les députés anglais n’ont aucune influence sur les affaires écossaises ?] Ils se demandent également pourquoi, si le Trésor britannique paie pour le Nord comme pour le Sud, les infirmières d’Ecosse ont droit à une augmentation de salaire immédiate, tandis que leurs consœurs d’Angleterre et du pays de Galles doivent attendre novembre. Un sentiment d’injustice s’empare de l’Angleterre. Un récent passage à ma librairie du sud de Londres a été l’occasion d’un échange révélateur. Le libraire, un homme cultivé à qui je raconte que je travaille à une émission de radio sur 1707, me demande : “1707 ? La guerre contre la France ? — Non, l’Union. L’Acte d’union. — Désolé, mais je ne vous suis toujours pas.” J’ai été vivement surpris du peu de place qu’occupe cette date dans la conscience collective des Anglais. Existe-t-il un autre peuple en Europe qui ne connaît pas la date de la création de son pays ? En Ecosse, cette date est bien plus importante que 1066 [année de la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant]. A l’école, on nous enseignait que 1707 était la date à laquelle notre pays avait décidé de s’autodétruire. Mon épouse et moi-même habitons un quartier d’Edimbourg où l’Union est célébrée par l’élégante architecture des Lumières. Chaque rue est un hymne aux vertus jumelles de la liberté et du commerce que l’Union a apportées à l’Ecosse : Rose Street et Thistle [Chardon] Street, symboliquement adjacentes, George Street croisant Hanover et Frederick Streets, en mémoire de la dynastie dont la pérennité a été assurée par l’Union. L’Edimbourg du XVIIIe siècle exprimait sa gratitude dans un geste plein de noblesse. Il a même été question de donner aux rues de la nouvelle ville d’Edimbourg la forme du drapeau de l’Union.
Les nationalistes peuvent remercier Mme Thatcher
Les raisons de cette gratitude étaient nombreuses. Lorsque l’Angleterre et l’Ecosse ont cessé d’exister pour former la Grande-Bretagne, le 1er mai 1707, les Ecossais ont eu accès à cet espace sur le point de devenir le plus grand empire commercial au monde. Glasgow a fait fortune grâce au tabac et au sucre. Le développement de l’industrie a vite suivi celui du commerce, prenant appui sur l’activité débordante des aciéries et des chantiers navals de la Clyde. En une génération, les Ecossais ont compris qu’ils avaient troqué leur souveraineté contre une chose bien plus importante : la prospérité. Grâce à l’Empire britannique, l’Ecosse s’est lancée dans le commerce avec le monde entier. Cet empire, nous l’avons construit presque seuls, non pas grâce à notre argent (nous n’en avions pas), mais grâce à notre génie et à notre discipline protestante. Quand j’étais enfant, l’Empire n’existait plus depuis longtemps. Le Commonwealth, c’était à cela que les gens pensaient quand ils disaient “l’Empire”. Pourtant, même le Commonwealth était en perte de vitesse. Edward Heath [Premier ministre britannique de 1970 à 1974] a lié le destin du Royaume-Uni à celui de l’Europe. Pour chaque génération du XXe siècle, l’Union a représenté différents idéaux. Aux yeux de mes grands-parents, c’était l’Empire ; pour mes parents, la guerre contre les nazis. Ma génération est le fruit d’une Grande-Bretagne différente, mais tout aussi cohérente, celle de l’Etat-providence de l’après-guerre et de la protection sociale garantie par le NHS [le système de santé public]. L’Etat britannique promettait de veiller sur vous du berceau jusqu’à la tombe. Les secteurs économiques stratégiques appartenaient à la nation britannique : le charbon, l’acier, les chemins de fer. La Poste installait votre téléphone. L’Etat vous fournissait le gaz avec lequel cuisiner et l’électricité avec laquelle éclairer votre foyer. Et les nationalistes voulaient mettre fin à tout cela ! C’est dans les années 1980 que les choses ont commencé à prendre un vilain tour, parce que quelqu’un a effectivement mis fin à cela : Margaret Thatcher a détruit le consensus de l’après-guerre. Elle a transformé la topographie économique : aujourd’hui, le marché est ouvert et global.
« Chaque année, l’Ecosse dépense 11 milliards de livres [16 milliards d’euros] de plus qu’elle ne collecte en impôts »
La société qui éclaire ma maison n’est même pas britannique. En réduisant ainsi le territoire de l’Etat, la révolution thatchérienne a eu pour effet pervers de saper le sentiment d’identité britannique des Ecossais. En Ecosse, pourtant, la révolution thatchérienne n’a jamais eu lieu. Pendant une décennie, l’Angleterre a voté avec enthousiasme pour le changement qu’apportait Thatcher, tandis que l’Ecosse faisait de la résistance. Jusqu’au milieu des années 1970, les comportements électoraux au nord et au sud de la frontière étaient similaires ; ce n’est qu’à cette époque que des divergences sont apparues, pour atteindre leur paroxysme dans les années 1990. Cet écart s’est avéré fortement préjudiciable à l’Union : celle-ci avait perdu sa valeur aux yeux de la population. Ainsi, le partenariat n’était plus bénéfique, il n’était qu’un instrument de contrôle par lequel l’Angleterre imposait à l’Ecosse les changements que celle-ci avait refusés dans les urnes. Il est temps de regarder les choses en face. Chaque année, l’Ecosse dépense 11 milliards de livres [16 milliards d’euros] de plus qu’elle ne collecte en impôts. Aux dires des partis unionistes, cela signifie qu’une Ecosse indépendante aurait un trou béant dans son budget. Même si certains grands patrons soutiennent l’indépendance, la plupart d’entre eux redoutent qu’une Ecosse indépendante ne doive augmenter les impôts, provoquant une fuite de l’activité économique et des capitaux. Le SNP objecte que ce montant de 11 milliards de livres ne tient pas compte des recettes pétrolières – que le Trésor britannique n’inclut pas dans les revenus fiscaux – et que l’or noir de la mer du Nord suffirait dans un premier temps à combler le déficit. A long terme, l’Ecosse reprenant le contrôle de son histoire, elle serait en mesure de mettre en place une politique de relance de la croissance, ce que lui interdit la situation actuelle. Cet argument prend tout son sens dans le contexte européen. L’année dernière, en voyage en Finlande, j’ai été frappé par les points communs de ce pays avec l’Ecosse : la Finlande, à la périphérie de l’Europe, compte environ 4 millions d’habitants ; elle a un voisin plus grand et plus puissant avec lequel elle a un jour formé une union [elle fut sous domination russe de 1809 à 1917]. Mais elle n’affiche pas 11 milliards de livres de déficit. Contrairement à l’Ecosse, la Finlande boucle elle-même son budget. Comment fait-elle ?
Le Royaume-Uni ne parvient plus à justifier son existence
En 1991, après la chute de l’Union soviétique, l’économie finlandaise a dégringolé, perdant 10 % par mois. Le nouveau gouvernement a pris des mesures draconiennes pour restructurer l’économie. Comme souvent, les choses ont empiré avant de s’améliorer : en un peu plus d’une décennie, le pays s’est hissé au niveau des grandes puissances économiques mondiales. Ce redressement aurait-il été possible si la Finlande n’avait pas eu la maîtrise de sa politique économique ? Le dirigeant de l’une des plus grandes sociétés de sécurité pour Internet m’a un jour confié : “Quand j’ai débuté, à la fin des années 1980, Nokia était encore un fabricant de bottes en caoutchouc et notre économie était fondée sur le bois. Nous avons loué un petit bureau à New York afin de pouvoir déclarer un siège, tandis que nous travaillions à Helsinki. Nous pensions que personne ne prendrait au sérieux une société de high-tech finlandaise.” Environ la moitié des vingt-sept Etats de l’Union européenne, dont la Finlande, sont moins peuplés que l’Ecosse. Si la Finlande est capable de gérer son budget, si l’Irlande l’est également, pourquoi ne le sommes-nous pas ? Le Royaume-Uni est en danger s’il ne parvient pas à justifier son existence autrement qu’en jouant sur la peur des Ecossais de perdre 11 milliards de livres : il fait de l’Ecosse un anachronisme dans cette Europe qui aspire à être l’espace économique le plus compétitif au monde, une région entretenant une culture de la dépendance nationale. Le prêtre palestinien avait peut-être raison : le danger réside dans la pauvreté des idéaux qui sous-tendent cet argument. Il existe par ailleurs un réel danger à long terme. La Grande-Bretagne, réduite à bien peu de choses – une communauté de pensées et un flux d’argent partant chaque année du Sud pour alimenter le Nord –, pourrait s’effondrer. Il y a peu de temps encore, comme au cours de la majeure partie de ses trois siècles d’existence, elle signifiait bien plus que cela.
Allan Little [2]
[1] Depuis sa création, en 1913, cette revue politique est le forum de la gauche indépendante, aussi réputée pour le sérieux de ses analyses que pour la férocité de ses commentaires. Le titre est, par définition, le journal de référence de l’intelligentsia de gauche britannique. Mais ses colonnes sont ouvertes à une large diversité d’opinions. Il a abandonné sa présentation austère pour une maquette plus aérée et colorée.
[2] Journaliste au service étranger de la BBC. Prix Bayeux du correspondant de guerre en 1994 pour un reportage sur Sarajevo.





 VERSION PDF
VERSION PDF IMPRIMER
IMPRIMER